 Ça y est, l'avion décolle, les vacances démarrent. Vous avez votre passeport, votre brosse à dents. Vous n'avez rien oublié. Vous avez même mangé avant le départ. Mais voilà, aussitôt que l'avion atteint sa vitesse de croisière, vous avez des ennuis imprévus : des ballonnements désagréables. Vous voilà victime des changements de pression en avion. La seule façon de soulager ces problèmes embarrassants engendrés par de l'air emprisonné dans votre système digestif passe par des éructations ou des flatulences. Le hic, c'est que les deux solutions sont toujours un peu gênantes. Si ce n'est pas le cas pour vous, ça peut l'être pour le siège voisin. Parlez-en à la centaine de passagers d'un avion d'American Airlines qui a été obligé de se poser d'urgence, en 2006, lorsqu'une passagère a été victime de flatulences en série. Les recherches menées par l'Académie nationale des sciences aux États-Unis ont conclu que les changements de pression dans un avion sont sans danger pour les passagers en bonne santé. Or, 40 % de la population nord américaine est diagnostiquée pour un trouble de santé. Au Québec, une personne sur deux souffre d'une maladie chronique1. Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire obstructive, d'une infection respiratoire, de problèmes de sinus, ou encore d'affections cardiovasculaires, il est conseillé d'en parler avec un médecin avant de prendre l'avion. Quant aux problèmes digestifs causés par les changements de pression subis en avion, on peut toujours se préparer en choisissant mieux ses repas avant de s'embarquer. Et aussi ce que l'on va consommer - ou pas - durant le vol. Dans un avion, l'air est pressurisé à une valeur entre 85 et 90 kilopascals, soit la pression atmosphérique à environ 6 000 pieds (2000 m). Quand l'avion atteint son altitude de vol, à plus de 30 000 pieds (10 000 m), l'air emprisonné dans le tube gastro-intestinal se dilate, selon un principe bien connu en météorologie, la loi de Boyle. L'expansion de cet air dans le corps peut alors atteindre 30 %. Pour réduire les ballonnements, on évitera certains aliments qui contiennent plus d'air que d'autres. D'autres types de nourriture sont aussi à fuir si vous souhaitez un vol paisible. Gare aux fruits et légumes, au gras et aux fèves au lard! Parmi les aliments qu'il serait préférable de s'abstenir de consommer avant ou pendant un vol, évitez les pommes, le chou-fleur et le brocoli, et bien entendu, les fèves au lard. Les fruits très fibreux ne sont pas faciles à digérer non plus. Et ils contiennent beaucoup d'air. Surtout le melon. La gomme est aussi quelque chose qui ne devrait pas être trop consommé en avion. Quand on mâche de la gomme, on avale beaucoup d'air. Ces bulles d'air vont peu à peu prendre de l'expansion dans l'estomac à mesure que l'avion prend de l'altitude. Sans compter que le sucre de la gomme risque de vous amener au petit coin plus souvent, ce qui est à éviter en avion. Le café est également un breuvage qu'on devrait s'abstenir de boire en vol. Pas seulement parce qu'il stimule la vessie, mais parce que le café - comme l'alcool - déshydrate beaucoup le corps. Or, dans un avion, l'air est horriblement sec. Il n'est pas rare de trouver dans les avions commerciaux des taux d'humidité relative de 6 %. En comparaison, l'humidité relative dans le désert du Sahara est de 27 %. Mais il n'y a pas que les problèmes de sécheresse et de digestion qui menacent les passagers en vol. Le sens du goût et l'odorat sont très affectés dans un avion. Pourquoi le sens du goût est influencé en avion? Dans un avion qui vole à 35 000 pieds, certains aliments ne goûtent plus la même chose. La sensibilité de nos papilles gustatives aux aliments salés et sucrés est réduite de 30 %, selon une étude menée par la compagnie aérienne Lufthansa en 2010. Pourquoi? Les raisons sont multiples. La sécheresse de l'air met à mal nos muqueuses nasales. Et c'est souvent avec le nez qu'on «goutte» plutôt qu'avec la langue. La pression plus basse affecte notre métabolisme. Le bruit très élevé dans un avion (85 décibels) est aussi un facteur. C'est l'équivalent du bruit engendré par la circulation automobile dans le trafic, avec klaxons et tout. Même le champagne ne goûte pas la même chose dans un avion. En effet, les nez fins sont nombreux à remarquer que le champagne semble toujours avoir un goût plus riche quand on le déguste à 35 000 pieds, comparé au plancher des vaches. Son goût est plus fin, plus complexe et plus agréable. Légende urbaine ou fait véridique? Difficile à savoir. Faudrait demander à Céline ou à Bono.
0 Commentaires
 Il y a pire que les coups de soleil et les cancers de la peau. Même si des précautions sont toujours à prendre quand on s'expose au soleil, le fait de s'abstenir d'en prendre semble beaucoup plus risqué pour la santé que d'en prendre trop. Le cancer est relié à de nombreux facteurs de risque : l'hérédité, le tabagisme, l'alcool, la pollution, la consommation de viande rouge, etc. Or, notre mode de vie moderne, qui nous fait passer presque tout notre temps à l'intérieur, nous fait oublier une chose essentielle : le meilleur remède naturel pour prévenir le cancer, c'est le soleil! Une simple marche de 15 minutes au soleil tous les jours pour une femme peut réduire de moitié le risque du cancer du sein. Des experts en prévention du cancer affirment même que les taux de cancer du sein sont en corrélation inverse avec l'exposition au soleil. Moins vous allez au soleil, et plus vous êtes à risque de développer un cancer. Aux États-Unis, le cancer du sein est beaucoup plus élevé dans les régions plus froides et plus nuageuses que dans les États ensoleillés du sud. Le risque peut même doubler pour certains types de cancers entre des régions comme la Nouvelle-Angleterre et le golfe du Mexique. On a même découvert que le risque de cancer du sein fatal dans les grandes villes américaines est inversement proportionnel à l'intensité de la lumière locale. Une étude qui a duré dix ans de la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins a conclu que l'exposition à la lumière solaire est positivement liée à la prévention du cancer du sein, du côlon et du rectum. La raison tient aux effets des rayons du soleil sur la peau. Les rayons ultraviolets du soleil interagissent avec une forme de cholestérol libérée par la peau exposée au soleil. Stimulés, le foie et les reins se mettent à fabriquer de la vitamine D3, une hormone connue pour améliorer le système immunitaire et empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Un nombre croissant de preuves statistiques et expérimentales démontre qu'une plus grande exposition au soleil réduirait la mortalité des cancers du système digestif et reproductif. Plusieurs médecins aux États-Unis, comme le Dr Richard Hobday, auteur de The Healing Sun, affirment que notre peur du soleil fait plus de mal que de bien. Et les recherches lui donnent raison. Le nombre de personnes qui meurent d'un cancer du sein, du côlon, de la prostate et des ovaires est beaucoup plus grand que le nombre de décès dus au cancer de la peau. Après avoir scruté 50 ans de littérature médicale sur le sujet, un chiropraticien américain, le docteur Gordon Ainsleigh, a conclu que les bénéfices de l'exposition régulière au soleil l'emportent sur les risques de vieillissement accéléré de la peau, et même de cancer. Plus récemment, une vaste étude impliquant 30 000 femmes suivies pendant 20 ans par des chercheurs de l'Institut Karolinska, en Suède, a révélé que les taux de mortalité chez les femmes qui évitent les bains de soleil sont deux fois plus élevés que chez celles qui prennent du soleil tous les jours. Bref, le dogme conventionnel d'éviter le soleil à tout prix semble faire plus de mal que de bien. Pour développer un cancer de la peau sous sa forme la plus mortelle, le carcinome, il faudrait au Québécois moyen 2 heures de soleil par jour pendant 50 ans. Or, non seulement le ciel est couvert 60 % du temps au Québec, mais les Québécois vivent de plus en plus à l'intérieur. Selon ParticipACTION, les Québécois ne passent qu'une à deux heures par jour à l'extérieur en été. Il n'y a pas que le froid et le temps moche qui incitent les gens à rester à l'intérieur. Les jeux vidéos, Internet et les médias sociaux ont beaucoup contribué à diminuer le temps passé à l'extérieur. Les activités de plein air sont en régression et n'intéressent plus les jeunes. Une indication qui ne ment pas : Scouts Canada estiment que le nombre de nouveaux scouts sera réduit à zéro en 2018. Les Scouts sont maintenant une espèce en voie de disparition.  Depuis une vingtaine d’années, des preuves s’accumulent sur le fait que les précipitations dans les grandes villes, surtout sur la côte Est américaine, ont tendance à se produire davantage les fins de semaine que les jours de semaine. Le mythe de la pluie qui tombe toujours le week-end serait-il vrai? Le phénomène touche les régions dans le couloir Toronto-Montréal et toutes les grandes villes de la côte Est des États-Unis où la pollution automobile augmente durant la semaine. Les polluants atmosphériques s’accumulent dans l’atmosphère et atteignent un maximum le vendredi ou le samedi. Les données des stations d’échantillonnage d’air confirment que les niveaux de deux polluants urbains, l'ozone et le monoxyde de carbone, augmentent à mesure que le weekend approche. Ces particules agissent comme des noyaux de condensation en formant des nuages qui déchargent alors leur trop plein les samedi et dimanche. Puis le cycle reprend le lundi suivant. Selon d’autres recherches du Centre d’Études Spatiales Goddard de la NASA, les grandes villes amplifient les précipitations et dégradent les conditions météorologiques dans les régions rurales autour. Des données de pluie collectées à Houston, Atlanta et Saint-Louis, entre 1998 et 2002, ont montré que la pluie augmente jusqu’à 44 % quand les vents soufflent vers la ville. À cause de cet effet de la pollution sur l’atmosphère, il y aurait 22 % plus de chance de pluie le dimanche, selon une étude de l’Université d’Arizona[1]. Le plus inquiétant, ont raconté les auteurs de cette étude, est de découvrir que la pluie est synchronisée avec l’activité humaine. Dans la même étude, 50 ans de données sur les tempêtes tropicales dans l'Atlantique Nord ont permis de démontrer l’existence de la même tendance avec les ouragans. Les ouragans aussi auraient tendance à suivre un rythme de 7 jours. Quand on réalise que la pollution qui se bâtit durant la semaine peut engendrer des catastrophes en fin de semaine, il y a de quoi être songeur. C’est l’effet papillon multiplié par des millions. Des millions d’automobilistes qui prennent la route le lundi. [1] Nature (2001) 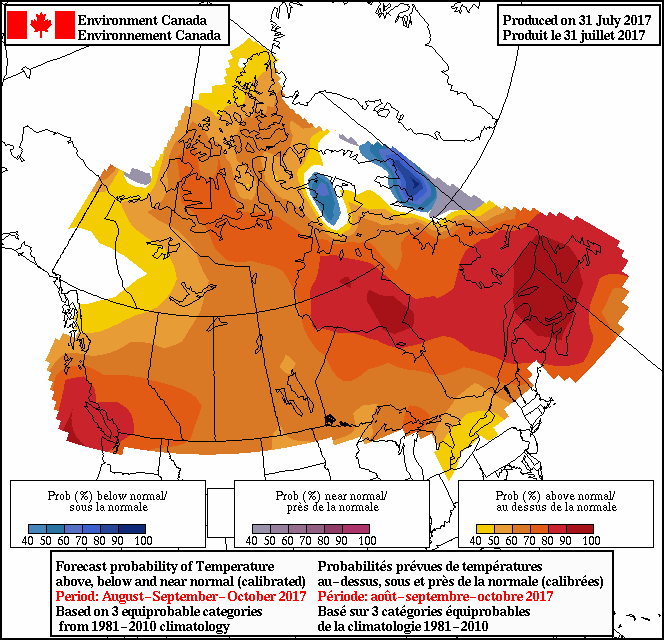 Selon les plus récentes prévisions saisonnières pour la deuxième moitié de l'été émises par Environnement Canada le 31 juillet, les températures se maintiendront largement au-dessus des moyennes normales de 30 ans sur le Québec d'ici octobre. Les indices de confiance sont élevés et atteignent 80 %. Ce sont les régions les plus à l'est du Québec qui devraient connaitre les conditions les plus chaudes par rapport aux normales. La pluie a été très peu présente dans le Bas-du-Fleuve, sur la Cote Nord et en Gaspésie cet été. Les températures plus chaudes dans l'Atlantique Nord contribuent à garder les secteurs de l'est avec les Maritimes sous l'influence d'une poussée d'air du sud. Quant aux précipitations, les prédictions à long terme d'Environnement Canada n'ont pas une très bonne habileté. Elles sont peu informatives. Néanmoins, on peut s'attendre à des précipitations normales pour les prochains mois avec peut-être un peu plus d'averses au sud de la vallée du Saint-Laurent. Compte tenu que les Québécois ont connu énormément de turbulences et d'écarts météo par rapport à la normale depuis le printemps, un retour à la normalité ne pourrait pas être pire que les épisodes d'orages, de grêle et de pluies abondantes que le sud du Québec a essuyé cet été. Rappelons que le Québec a connu des quantités de pluie record en avril, mai et juin.  Les essais nucléaires souterrains de la Corée du Nord sont hautement surveillés par une équipe de scientifiques basée à Dorval qui travaille jour et nuit afin de détecter la moindre particule radioactive, même à des milliers de kilomètres. Ces essais suscitent l’inquiétude dans l’équipe d’Yves Pelletier, chef de la Section de réponse aux urgences environnementales d’Environnement Canada. Depuis une vingtaine d’années, les scientifiques du Centre météorologique canadien (CMC) détectent et suivent toute matière dangereuse dans l’atmosphère – cendres volcaniques, incendies de forêt ou panaches de fumées toxiques – un peu partout dans le monde. Mais le Canada est aussi l’un des huit centres météorologiques spécialisés en urgences nucléaires de l’Organisation météorologique mondiale. À la grandeur de la planète Dans les faits, le CMC de Dorval surveille toute explosion nucléaire dans le monde à partir d’un réseau de stations réparties partout sur la planète. La bête noire traquée par les météorologues et les capteurs: des radionucléides, des particules de poussière avec une signature radioactive qui ne ment pas. Ces radionucléides permettent d’identifier des explosions nucléaires, mais aussi de connaître leur source d’émission.«Pour détecter une explosion nucléaire, explique Yves Pelletier, chef de la Section, le réseau de surveillance utilise quatre approches. Des séismographes, des microphones sous-marins, un monitoring des infrasons et des radionucléides détectés dans l’air. Même si l’explosion est souterraine, il peut y avoir des émanations dans l’atmosphère.» Reculer dans le temps Pour déterminer la provenance des particules, l’équipe du CMC procède à de la modélisation inverse. On fait fonctionner les modèles météo en reculant dans le temps. Ce qui permet de suivre l’écoulement des vents dans les heures et les jours précédents. On arrive ainsi à déterminer précisément la source locale. En quelques minutes, toute explosion peut être détectée et localisée. Quelques heures après, les paramètres sont déjà analysés. Un programme informatique très puissant fait ensuite les calculs et confirme que l’explosion est d’origine humaine, sa puissance, sa force, etc. Toutes les données sont finalement transmises au siège de l’Organisation, à Vienne. L’équipe des mesures d’urgence du CMC fait partie d’un large regroupement de laboratoires, de centres de données et d’organisations gouvernementales consacrés à la sécurité publique. Le Canada fait partie de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et collabore à la surveillance mondiale comme une police de l’atmosphère. Dorval est l’un des huit centres de détection chargés par l’ONU de déterminer l’origine de toute explosion atomique. Sauf que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) est une entente internationale qui, si elle existe depuis 1996, n’a jamais été en vigueur officiellement. Ce traité interdit toute explosion nucléaire à des fins pacifiques ou militaires, dans quelque environnement que ce soit. Surveillance mondiale Pour s’assurer que les États membres se conforment aux dispositions du traité, celui-ci prévoit un système de surveillance mondial afin de détecter toute explosion atomique dans l’air, dans le sol ou dans l’eau de la planète. Le traité a été signé par 180 pays, ratifié à 85 %, mais n’a jamais été adopté par l’ONU. Cinq pays bloquent la mise en vigueur de cet accord en refusant de le ratifier. Ces pays sont les États-Unis, la Chine, l’Égypte, Israël et l’Iran. La Corée du Nord, quant à elle, n’a jamais signé l’entente. Ses cinq tests nucléaires depuis 2006, le dernier ayant eu lieu le 6 janvier 2016, ont suscité des protestations partout dans le monde.  De l’achat d’un parapluie à une décapotable, en passant par la vente de soupe, de bière et d’électricité, une grande part de l’économie subit les contrecoups de la météo. Les habitudes de consommation changent avec le mercure et les saisons, révèlent des recherches. Quand le printemps est moche, on remarque un certain effet de rattrapage dans la consommation dans les mois suivants. Comme si les gens cherchaient à compenser. Cet effet est très fort au Québec. Les gens se précipitent sur des forfaits voyages dans les jours qui suivent les grands froids. Le tourisme, l’énergie, la restauration, l’agroalimentaire. Tous les secteurs de l’économie sont touchés par la météo. Comment votre façon de dépenser est influencée par la température ? Coup d’œil sur l’économie comportementale, un nouveau champ d’études en train de faire sa place au soleil. Les compagnies de production cinématographiques au Québec sont parmi les entreprises les plus dépendantes de la météo. Vous cherchez un barbecue ? Des articles de jardin ? Des vêtements d’été ? Attendez que la température atteigne au moins 15 °C avant de vous pointer au magasin. C’est le seuil où les consommateurs se mettent en mode été. Les commerçants le savent. C’est pourquoi vous perdez parfois un temps fou à chercher en vain de l’insecticide ou de la crème solaire en plein mois de janvier alors que vous partez en voyage dans le Sud le lendemain. « Les conditions météo peuvent affecter 30 % du box-office, estime le distributeur Patrice Roy. Le pire, c’est les tempêtes de neige. Quand toute la ville est paralysée, ça ne se bouscule pas sur le tapis rouge ». Mais d’un autre côté, le soleil fait fuir les cinéphiles, dit-on. Mythe ou réalité ? Pour le savoir, une étudiante à l’école des Hautes études commerciales (HEC), Sarah-Émilie Chan, s’est penchée sur l’impact de l’ensoleillement sur la fréquentation des salles de cinéma pour son mémoire de maîtrise en marketing. En croisant les données d’affluence de 247 films projetés au Québec et les archives météo, Sarah-Émilie a confirmé le mythe. Plus il fait beau, et plus les Québécois boudent le cinéma. Vincent Guzzo, président des Cinémas Guzzo, le sait depuis longtemps. « Tous les films, quand il pleut, ça aide beaucoup. » Les femmes seraient plus affectées que les hommes par cet effet de la météo, selon Climpact-MetNext, une compagnie française spécialisée dans le risque météo. D’après les recherches qu’a menées la firme, si la température descend de 1 degré sous la normale, les ventes chutent de 8 % dans le prêt-à-porter féminin, contre 2 % au rayon des hommes. Par contre, si vous vendez de la bière, le bénéfice est beaucoup plus grand. Dès que le mercure atteint 20 °C, chaque degré supplémentaire fait grimper votre chiffre d’affaires de 5 %. ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE L’influence de la météo sur la consommation nous rappelle que les humains ne sont pas des robots dénués d’émotions. Lorsque nous prenons des décisions d’acheter ou d’investir, c’est notre perception du monde qui guide nos choix. Ce sentiment est influencé par ce qui se passe dans notre environnement. Même la couleur des murs et certaines odeurs, selon des études, auraient le pouvoir d’affecter notre intention d’acheter. Au Québec, les ventes de véhicules 4x4 sont toujours à la hausse durant les semaines qui suivent une importante chute de neige. Et quand le soleil brille trop fort, les acheteurs délaissent les voitures aux couleurs foncées. C’est ce qu’on appelle l’économie comportementale, une preuve convaincante de l’emprise de la météo et du climat dans la vie des gens.  Beaucoup de produits pharmaceutiques sont affectés par la météo. La température, l'humidité, la présence de soleil, même la pression barométrique, ont des impacts sur le bon fonctionnement du médicament. L'aspirine, la cocaïne, l'alcool, la marijuana, de même que certains antidépresseurs auront des effets différents en fonction du mercure. Le médicament en tant que tel ne change pas. C'est le corps qui change au fil des jours, mais aussi en fonction du climat. Certains médicaments réagissent avec la pression et n'auront pas le même effet en montagne ou en avion. Des changements brusques à la météo peuvent causer des fluctuations imprévues dans la puissance du médicament et son potentiel toxique. Les conséquences peuvent être dramatiques. En France, suite à la vague de chaleur mortelle qui a touché Paris en 2003, il a été établi que certains traitements médicamenteux avaient favorisé des coups de chaleur ayant causé la mort1. Les médicaments oraux comme l'insuline ont une plage de température thérapeutique en dehors de laquelle le produit perd de son efficacité. Même si les personnes diabétiques savent qu'il faut protéger les médicaments contre la chaleur, les sondages révèlent que 37 % des patients laissent toujours leurs médicaments à la maison ou dans l'auto, à la chaleur ambiante. Les fabricants pharmaceutiques recommandent que les médicaments soient toujours entreposés à une température ambiante de 20 à 25 degrés Celsius. En vérité, c'est généralement la plage de température à laquelle les fabricants garantissent l'efficacité de leur produit. Pendant les vagues de froid ou de chaleur, la température des endroits habituels où les gens gardent leurs médicaments peut être beaucoup plus élevée ou plus basse. Ces conditions dégradent la puissance du produit. Pour les patients atteints de diabète ou d'une maladie cardiaque, une dose plus grande ou plus faible d'insuline ou de nitroglycérine peut être mortelle. Tous les types de tests sanguins qui utilisent des bandes qu'on se met sur la peau, comme ceux utilisés pour tester les niveaux de sucre dans le sang, la grossesse ou l'ovulation, sont extrêmement sensibles à l'humidité. Si l'humidité colle aux bandes, celle-ci va diluer l'agent actif et peut causer une fausse lecture. Gare aux jours de canicules dans ces situations. Pour leur part, les médicaments qui contiennent des hormones comme la pilule contraceptive sont très vulnérables aux changements de température. Gardez toujours vos médicaments dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. Et surtout, jamais dans l'armoire à pharmacie usuelle. C'est souvent le pire endroit pour garder ses médicaments en raison de la grande humidité et de la température habituellement plus élevée dans la salle de bains. L'humidité a la fâcheuse habitude de faire dissoudre rapidement les comprimés. 1Cusak L, de Crespigny C et Athanasos P., Heatwaves and their impact on people with alcohol, drug and mental health conditions : a discussion paper on clinical practice considerations. J. adv. Nursing, Jan 2011, 67: 915-922 ici pour modifier.  Une personne sur cinq a des migraines assez sévères pour nuire à son travail, ses études ou son sommeil. Au Canada, trois millions de personnes souffrent de migraines de façon régulière. Dans un sondage effectué en 2013 par la National Headache Foundation aux États-Unis, trois patients migraineux sur quatre affirment que leurs maux de tête sont déclenchés par les conditions météo. Les variations brusques d'humidité de température, le temps chaud et humide, les orages et les vents forts semblent être les pires détonateurs de migraines. Superstitions ou sagesse populaire? Qu’en est-il réellement? L'une des premières études sur le sujet est canadienne et remonte à 1981. Le climatologiste en chef d'Environnement Canada, David Phillips, a étudié la question. Ses conclusions convergent avec celles de la plupart des études faites sur le sujet un peu partout dans le monde. Les migraines sont à la hausse quand la pression barométrique varie beaucoup et que les températures et l’humidité grimpent dans votre région après l’arrivée d’une masse d’air chaud. Avoir un mal de tête est une chose tout à fait normale dans la vie. Les migraines, pour leur part, constituent des conditions médicales sérieuses qui nécessitent des soins immédiats. Les spécialistes sont encore en train de percer les mystères de la migraine. Au départ, les migraines sont causées par la vasoconstriction des artères du cortex, qui entrainent à leur tour la vasodilatation des artères des méninges et du scalp. À partir de là, on ne s’entend plus pour savoir ce qui se produit ensuite. Ce que l’on sait, c’est que les baisses de pression barométrique provoquent une rétention d’eau, un gonflement des tissus, et une hausse de pression dans le cerveau. Les masses d’air chaud, pour leur part, dégradent généralement la qualité de l’air. L’air chaud est moins revitalisant que l’air froid car il contient moins d’oxygène.[1] Dans son livre How to find relief from Migraine, la fondatrice de la fondation canadienne des migraines, Rosemary Dudley, conclue qu’il n’y a que deux endroits au monde où l’on peut éviter les migraines en raison des conditions météo qui y règnent. Ces lieux sont réputés surtout pour la forte pression barométrique ambiante car ils se trouvent sous le niveau de la mer. Malheureusement, ils sont un peu difficiles d’accès. C’est la Mer Morte, entre Israël et la Palestine, dans une des régions les plus dangereuses au monde. Et le Grand Canyon en Arizona! [1] Pour un même volume et une même pression selon la loi des gaz parfaits [2] Weather and air pollution as triggers of severe headaches. Neurology; 2009 Mar 10;72(10):9227 2 Shifts from Daylights Saving Time and Incidence of Myocardial Infarction, N Engl J Med 2008; 359 : 1966-1968  Le temps frais et pluvieux sur le sud du Québec persistera au début juin alors que Montréal s'apprête à accueilir le Grand Prix de Formule 1. Les conditions s'annoncent bonnes pour l'événement. Le temps reste instable au cours des prochains jours. Des averses localisées pourraient être possible dans la fin de semaine du 10 juin. Mais rien de comparable aux pluies torrentielles tombées en 2015 à Austin au Texas, lors du Grand Prix des États-Unis. La météo le jour du Grand Prix est d'une importance capitale. Pas autant pour le public que pour les voitures, des merveilles de technologie. Les mordus de Formule 1 se souviennent du carambolage monstre qui a fait avorter le Grand Prix d'Angleterre 1975, lorsque des bolides avaient roulé avec des pneus pour temps sec sur une piste humide après une simple averse. Depuis le début du Grand Prix dans les années 50, une cinquantaine de pilotes se sont tués au travail. Dans bien des accidents comme dans bien des victoires, l'influence de la température, du vent et des précipitations avaient joué un rôle critique. Sur le pilote et sa voiture, mais aussi sur l'état de la piste. Un sol détrempé par de la pluie la veille, ou un sol très sec le jour de la course peut faire toute la différence. De même, le vent et un air trop froid ou trop chaud affectent l'aérodynamisme de la voiture. Mais ce sont les pneus qui comptent. La vie utile d'un pneu est d'environ 80 000 km. Les pneus de Formule 1, eux, sont bons pour la poubelle après une seule journée d'usage. C'est souvent le secret de la victoire: choisir le bon type de pneumatiques au bon moment.  Dans le rapport sur le cafouillage de l’A13 déposé le 19 mai, une recommandation est faite aux autorités de créer une échelle de tempête de neige comme pour les ouragans. Même si l’idée peut sembler intéressante à première vue, on réalise vite qu’une telle échelle ne fonctionnerait pas. Pour une raison toute simple. Les échelles qui évaluent la force des ouragans sont basées sur les vents. Pas sur les précipitations. Ue tempête de neige qui frappe le Québec n’affecte pas toutes les villes de façon égale. Une chute de 15 cm à Saint-Tite ne cause pas d’ennuis. Mais à Montréal, c’est le bordel. Dans son rapport, l’enquêteur écorche Environnement Canada qui a sous-estimé les accumulations de neige. Il est surtout là, le problème. Les désinvestissements en météorologie par le gouvernement fédéral en 20 ans annonçaient une tempête parfaite. Fermeture de bureaux et de stations météorologiques. Coupures de programmes d’observations. Réduction des effectifs. Le Québec, avec 1,5 millions de kilomètres carrés ne compte qu'un seul centre de prévision. Le Texas, avec un territoire moitié moins grand, compte 11 bureaux météorologiques! Est-il normal qu’une grande ville comme Montréal soit dépendante d’un radar désuet de la deuxième guerre mondiale, réputé pour tomber toujours en panne?! Environnement Canada a perdu la gérance de son superordinateur en 2012 à la création de la nouvelle agence regroupant les services informatiques du fédéral. Cette agence gérant le superordinateur de la météo est la même organisation responsable du fiasco informatique du programme de paye des employés du gouvernement fédéral. Pas étonnant dans tout ce contexte que la performance des services météo d’Environnement Canada se détériore. Mais la vérité est qu’il y a aussi une raison culturelle expliquant le cafouillage de l’A-13. Comme le dit l’auteur du rapport de Transport Québec : « On a été élevés dans les tempêtes de neige, donc ça n’effraie pas trop les Québécois. » Il est là le nœud du problème. Plus personne n’écoute les alertes météo. Environnement Canada a certes un travail de réflexion à faire sur son système d’alertes, calqué à 100% sur les américains alors que le climat canadien est très différent. Les changements climatiques vont nous obliger à ouvrir l’œil et prêter l’oreille davantage aux extrêmes météo. Les inondations historiques que le Québec a connues ce printemps nous le rappellent. |
 Flux RSS
Flux RSS
